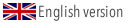Natif de la Roche-sur-Yon, formé à la cuisine avant une spécialisation en sommellerie au lycée hôtelier de Talence en 1994, David Biraud, chef sommelier du Mandarin Oriental de Thierry Marx est arrivé second au Concours du Meilleur Sommelier du Monde organisé en Argentine en avril. Retour sur une épreuve et un parcours et analyse des mouvements en cours dans le monde du vin. Du bio aux amphores.
A voir les épreuves imposées lors du championnat de sommellerie, on se dit que la connaissance qu’un sommelier doit ingurgiter semble sans limite ? Cela va jusqu’à la réalisation des cocktails.
Un sommelier doit tout connaître des liquides servis dans un restaurant : leur histoire, leur zone d’élaboration, leur méthode de production et la législation et ce, qu’il s’agisse d’eaux, de vins, de liqueurs, de thés, cafés, sodas, ou cocktails… Cette année, j’avais mis l’accent sur la théorie. Je connaissais la liste de cocktails de la coupe Scott – le référentiel de base à connaître par tout barman soit 40 short drinks et 40 long drinks.
Mais c’est la gestuelle et la réalisation qui ont pu poser problème. On sous-entend que l’on doit avoir des connaissances. Mais le temps n’est pas extensible.
Justement, comment s’entraîne-t-on pour une telle épreuve ?
Je m’étais préparé à bien des cas de figure par exemple à ce qu’un client me dise « je suis allergique aux sulfites, est-ce que vous pouvez me proposer des accords avec d’autres boissons ». J’avais prévu des thés, des bières jusqu’à des vins de fruits.
Je me suis entraîné chaque semaine avec l’aide de six collègues. Franck Ramage à l’école du Cordon Bleu pour l’anglais et le côté scolaire, au Petit Sommelier avec Pierre Vila Palleja pour une ambiance bistrot, mais aussi à l’Atelier des Compères avec Jacques Boudin ou au Baltimore avec Jean-Luc Jamrozik. Je me suis aussi entraîné chez Yam’Tcha pour les accords avec les plats asiatiques et les thés.

Justement pour les accords mets-vins que vous avez proposé durant la compétition, vous êtes largement sorti du cadre gastronomique français ?
Jonathan Bauer-Monneret du restaurant Spring m’a conseillé de penser à des accords mets vins internationaux comme des tempura des crevettes tigrées avec basilic thaï.
Y-a-t-il eu des évolutions fortes dans le vin que vous n’avez pas vu venir durant ces vingt dernières années ?
Globalement, on sent venir les tendances. Dans les années 80, on a fait croire que l’œnologie résolvait tous les maux … La décennie suivante c’était terminé. En 1994, j’ai vu les prémices des nouveaux styles de vinification dans le bordelais. Il y a eu l’accent mis sur la maturité lié à l’influence d’un dégustateur hors-norme comme Robert Parker. Il a rendu service aux vignobles bordelais. Et à d’autres. Avec son palais d’américain, il a fait prendre conscience que la maturité du cabernet sauvignon n’était peut-être pas au top. Idem pour le travail du merlot. Et de fait, aujourd’hui, les Bordelais s’en sortent plutôt bien globalement. Il n’y a plus vraiment de mauvais millésimes.
Parker était aussi à l’origine du sur-boisé ?
C’est vrai. Mais l’ultra-boisé, dont on revient aujourd’hui, était aussi une demande de la clientèle.
Et en Bourgogne ?
J’ai connu les vins « graissés » à outrance avec une recherche de densité extrême et des extractions sur le pinot comme si on voulait imiter le bordelais. Avec des conséquences entre 1996 et 2002 sur l’oxydation des grands bourgognes blancs. Ce n’était pas la faute des bouchons comme on l’a dit. Aujourd’hui, certains ne bâtonnent plus et laissent davantage sur lies fines.
Il y a aussi le bio ?
Le bio m’a convaincu. En revanche, je ne suis pas dans la mouvance des « ayatollahs » du vin nature. Quand on veut vraiment obtenir la quintessence d’un terroir, il faut quelque peu protéger ses vins pour maintenir la finesse et l’élégance aromatique. Or quand les « nature » dérapent, ils ont tous la même odeur…
Enfin l’actualité m’interpelle sur cette mode des vins en amphore et en terre cuite. Autant je goûte les vins géorgiens avec ces vinifications dans des énormes jarres enterrées qui donnent des résultats bluffants, mais c’est un résultat historique chez eux. Chez nous, je n’ai pas été convaincu. Même des vignerons admettent que des vinifications en terre ne fonctionnent pas pour certains cépages. La terre transpire … Déjà qu’il y a des problèmes dans les bois. Alors d’où vient la terre de leurs amphores, est-on sûr de sa provenance. Je n’ose imaginer. Il vaut mieux garder ça à titre expérimental.
Le béton me gêne moins, ne serait-ce que parce que ça fait un bail qu’il existe. En Argentine, les plus beaux malbecs sont vinifiés dans le béton. Il y a une élégance qui s’installe dans la vinification béton. Je suis beaucoup moins méfiant. Après tout le chai de Petrus est bien en béton.
Au-delà du réchauffement climatique, je suis inquiet pour la Bourgogne avec ces épisodes réguliers de gel, de grêle et ces mini-tornades. Comment expliquer qu’à Volnay ou à Pommard on se « tape » tous les ans un passage de grêle. Je suis inquiet sur les Hautes-Côtes, la Bourgogne a toujours marché avec les courants d’air froid des combes, si on perturbe ces courants d’air par certaines déforestations, cela peut avoir des effets sur les mouvements d’air et de températures. Dans les années 90, il me semble que les Bourguignons n’avaient pas ce genre de « poisse ».